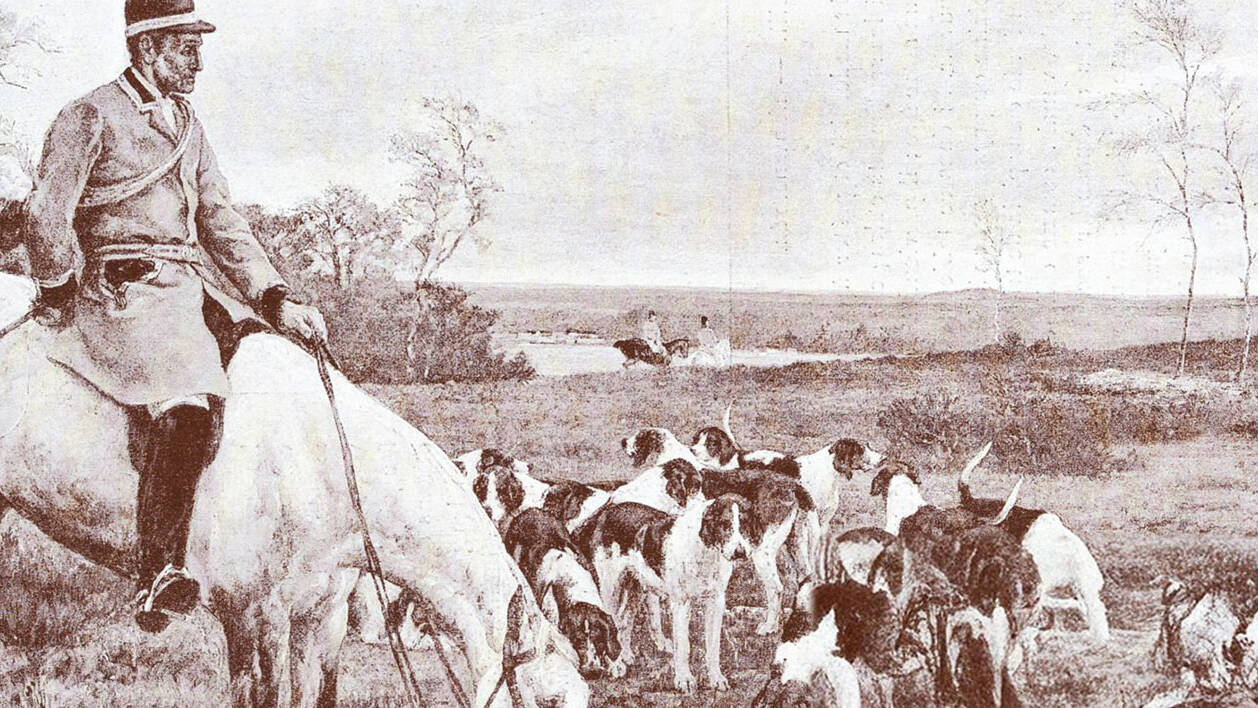DÉCOUVRIR LA CHASSE À COURRE – Héritage
Patrimoine de la chasse à courre
Assurer la pérennité de la vènerie, maintenir ce patrimoine culturel et cynophile vivant unique au monde, entretenir cette connaissance cynégétique exceptionnelle sont autant de missions et responsabilités qui incombent aux veneurs d’aujourd’hui. Chasser à courre au XXIe siècle n’est pas une démarche anodine, c’est même un acte engagé. Les veneurs sont en quelque sorte les dépositaires d’une tradition séculaire inestimable. Leur détermination est à la hauteur de cet enjeu, elle permettra aux générations futures de vivre les joies immenses des laisser-courre.
Patrimoine culturel
Les musées

Musée de la vènerie à Senlis (Oise)
Installé dans le logis du prieuré Saint-Maurice du XVIIIᵉ siècle, ce musée évoque la dimension culturelle et artistique de la chasse à courre. Il présente des tableaux, gravures, photographies, objets d’art et accessoires utilisés pour ce mode de chasse.

Musée de la chasse et de la nature à Paris (Ile-de-France)
Situé dans le Marais, ce musée prestigieux est consacré à la chasse sous toutes ses formes. Il propose une approche artistique, philosophique et historique de la relation entre l’homme et l’animal, avec une riche collection de peintures, sculptures, armes, trophées et objets de vénerie.

Musée du veneur au Château de Montpoupon (Indre-et-Loire)
Ce château privé abrite un musée dédié à la vénerie et aux traditions de la chasse à courre. Les collections comprennent des tableaux, équipements de chasse, uniformes et accessoires des équipages de vénerie. Les anciens chenils et écuries du château sont également visitables.

Musée du Château de Gien (Loiret)
Installé dans le château de Gien, ce musée retrace l’histoire de la chasse à travers des collections d’armes, trophées, documents et objets d’art liés à la vénerie. Il présente également une section sur la chasse au vol et la fauconnerie.

Musée de la vènerie de l’Abbaye du Val des Choues (Côte-d’Or)
Ce musée-opéra propose un parcours respectueux des grandes traditions de présentation, en y associant un nouveau regard sur la chasse à courre avec la contribution d’artistes contemporains de renom.
Patrimoine artistique
Depuis toujours les peintres animaliers se sont inspirés de ce thème. Aujourd’hui encore, l’explosion de la photographie, les très nombreux livres et essais consacrés à l’art de la vènerie et à sa pratique montrent combien elle inspire les artistes.
Les peintres
Voici une présentation de quelques peintres majeurs de la vènerie :

Alexandre-François Desportes (1661-1743)
Desportes est un des premiers grands peintres animaliers en France. Il est célèbre pour ses tableaux représentant des scènes de chasse, des meutes de chiens et des natures mortes avec du gibier. Il a travaillé pour la cour de Louis XIV et Louis XV, réalisant des commandes pour les châteaux royaux.

Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)
Oudry est un peintre majeur du XVIIIe siècle, spécialisé dans les scènes de chasse et les animaux sauvages. Il a produit des œuvres monumentales pour les châteaux royaux et a illustré plusieurs ouvrages de chasse. Ses peintures sont marquées par un réalisme saisissant et une grande précision anatomique.

Charles-Olivier de Penne (1831-1897)
Peintre et illustrateur, De Penne est particulièrement réputé pour ses représentations de meutes de chiens et de scènes de chasse à courre. Ses œuvres montrent une grande maîtrise du mouvement et de la dynamique entre les chasseurs et les animaux.

Karl Reille (1886-1975)
Karl Reille est considéré comme l’un des derniers grands peintres de la vènerie. Il a consacré sa carrière à immortaliser les scènes de chasse à courre, les chevaux et les chiens avec une grande fidélité aux traditions et un style très expressif.
Ces artistes ont contribué à perpétuer l’image de la vènerie à travers leurs œuvres, qui restent aujourd’hui des références pour les amateurs de chasse et d’art.
Les sculpteurs
Les principaux sculpteurs de la vènerie sont :

Antoine-Louis Barye (1795-1875)
Maître de la sculpture animalière, Barye a excellé dans la représentation des animaux sauvages en action. Ses bronzes de cerfs, chiens et scènes de chasse sont empreints de dynamisme et de réalisme.

Christophe Fratin (1801-1864)
Contemporain de Barye, Fratin s’est spécialisé dans les sculptures d’animaux, souvent en mouvement. Ses œuvres comprennent des scènes de chasse et des meutes de chiens en pleine action.

Jules Moigniez (1835-1894)
Sculpteur prolifique, Moigniez est reconnu pour ses bronzes d’animaux, notamment les chiens de chasse et les gibiers. Ses œuvres sont très détaillées et souvent pleines de mouvement.

Pierre-Jules Mêne (1810-1879)
Mêne est l’un des sculpteurs animaliers les plus célèbres du XIXe siècle. Il a produit de nombreuses œuvres représentant des chevaux, chiens et scènes de chasse avec un réalisme impressionnant.
Patrimoine architectural
les Châteaux
Le patrimoine architectural de la chasse à courre est riche et varié, reflétant l’importance historique de cette pratique en France et en Europe. De nombreux châteaux ont été construits ou aménagés pour la chasse. Parmi les plus emblématiques :

Château de Chambord (Loir-et-Cher)
Commandé par François Ier, Chambord est entouré d’un immense domaine de chasse (5 440 hectares), toujours utilisé aujourd’hui. Son escalier à double révolution aurait été conçu pour que chasseurs et domestiques ne se croisent pas.

Château de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Résidence favorite des rois pour la chasse, Fontainebleau est entouré d’une forêt riche en gibier. Il possède une galerie des chasses et des pavillons disséminés dans le domaine.

Château de Compiègne (Oise)
Réaménagé par Napoléon Ier, ce château était un centre important de la chasse impériale. Il est entouré de la forêt de Compiègne, toujours fréquentée par les veneurs.

Château de Chantilly (Oise)
Haut lieu de la vénerie sous les Condé, Chantilly dispose d’un vaste domaine forestier et de chenils historiques.

Chateau de Versailles (Yvelines)
Le Château de Versailles et ses environs ont été un haut lieu de la chasse à courre sous l’Ancien Ré La chasse y était une activité essentielle de la cour, notamment sous Louis XIV et Louis XV, qui en étaient passionnés.
Les pavillons
Les pavillons et relais de chasse, souvent isolés en forêt, sont pour certains, de véritables joyaux architecturaux.

Pavillon de la Muette (Yvelines)
Construit pour Louis XV en plein cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il servait de halte lors des chasses royales.

Pavillon de chasse du Roi à Rambouillet (Yvelines)
Ce pavillon a été utilisé par plusieurs souverains, dont Louis XVI et Napoléon Ier, pour leurs parties de chasse dans la forêt de Rambouillet.
Aujourd’hui, ces lieux continuent d’attirer les passionnés de chasse, d’histoire et d’architecture.
Patrimoine linguistique
La vénerie possède un vocabulaire riche et spécifique, héritage d’une tradition pluriséculaire. Ce langage technique et imagé s’est transmis à travers les générations de veneurs et reste en usage dans les équipages de chasse à courre.
Certains de ces mots très usités sont tombés dans le langage courant à travers des expressions que nous connaissons tous.
- « Être aux abois »
Signification : Être dans une situation très difficile, sans échappatoire, acculé par les circonstances.
Origine : En vénerie, un animal est « aux abois » lorsqu’il est cerné par les chiens de la meute.
- « Être d’attaque »
Signification : Être prêt à agir, dans un état d’esprit ou de forme optimal pour faire face à une situation ou à un défi.
Origine : Cette expression vient de l’idée que, dans la chasse à courre, un veneur ou un chien « d’attaque » est celui qui est prêt à « lancer » ou « attaquer » un animal.
- « Courir deux lièvres à la fois »
Signification : Tenter de réaliser deux objectifs ou de s’occuper de deux choses simultanément, souvent avec l’idée qu’on risque de ne réussir aucune des deux.
Origine : Dans la chasse à courre, on ne chasse qu’un animal à la fois pour multiplier les chances de le prendre. Si les chiens s’éparpillent, ils n’en prendront aucun.
- « Donner le change »
Signification : Tromper quelqu’un en lui faisant croire quelque chose qui n’est pas vrai, en donnant une fausse impression.
Origine : Cette expression vient de la chasse à courre, où l’animal se mêle à d’autres individus de la même espèce pour livrer un autre animal à sa place.
- « Prendre les devants »
Signification : Agir en anticipant, prendre une position ou une décision avant qu’une situation ne se développe.
Origine : Cette expression se réfère au fait de « prendre les devants » dans une chasse, en se plaçant à un endroit stratégique avant l’arrivée de l’animal chassé.
- « Être un fin limier »
Signification : Être une personne perspicace, capable de comprendre rapidement et de résoudre des problèmes complexes.
Origine : Un « limier » est un chien de chasse, en particulier un chien sûr de nez utilisé pour faire le bois les matins de chasse.
- « Mettre sur la voie »
Signification : Orienter quelqu’un, lui donner un indice ou une direction pour qu’il trouve une solution ou atteigne un objectif.
Origine : En vènerie, mettre les chiens « sur la voie » signifie les guider vers l’endroit où est passé l’animal.
- « Relancer quelqu’un »
Signification : Essayer de nouveau d’obtenir quelque chose de quelqu’un, reprendre contact avec lui.
Origine : Cette expression provient du fait de « relancer » l’animal après un défaut, c’est à dire quand les chiens ont perdu sa trace.
- « Prendre son parti »
Signification : S’engager sans revenir en arrière souvent après avoir hésité ou confronté diverses options, faire un choix définitif.
Origine : Dans la chasse à courre, « prendre son parti » signifie que l’animal emprunte une franche direction.
- « Être sur la bonne voie »
Signification : Être sur le bon chemin, dans une situation ou dans une réflexion qui semble mener à une conclusion ou à un succès.
Origine : Dans la vénerie, être « sur la bonne voie » signifie que les chiens suivent correctement la voie de l’animal de chasse. On dit aussi qu’ils chassent « dans le droit ».
Ces expressions illustrent bien comment le lexique de la vènerie a laissé son emprunte dans le langage courant, tout en enrichissant le sens des mots et des métaphores.
Patrimoine musical
Depuis toujours, les veneurs ont utilisé un instrument de musique pour communiquer entre eux. Ce fut d’abord le huchet, suivi de la corne, puis de différentes formes de trompes, jusqu’à l’apparition de la trompe d’Orléans, qui est encore utilisée aujourd’hui. Refusant d’utiliser des moyens électroniques modernes, les veneurs se servent de la trompe de chasse pour signaler les circonstances de la chasse, appeler ou appuyer les chiens mais aussi rendre hommage à l’animal lors de la curée. La trompe de chasse est un instrument à part entière, qui trouve également sa place dans des concerts musicaux.
La trompe de chasse est apparue vers 1680. Initialement accordée en do et ressemblant à la trompette de cavalerie, elle a pris son ton actuel en ré dès 1705, en adoptant la longueur que nous lui connaissons aujourd’hui : 4,545 mètres. À ses débuts, elle était enroulée sur un tour et demi, avec un diamètre de 73 centimètres. Ce modèle a été appelé « à la Dampierre », en hommage à l’auteur des célèbres fanfares. En 1729, l’instrument a été modifié pour être enroulé sur deux tours et demi, avec un diamètre de 55 centimètres, et a été désigné « à la Dauphine ». La trompe dite « d’Orléans » a vu le jour vers 1818, conservant les mêmes caractéristiques que les versions précédentes, mais avec 3 tours et demi et un diamètre réduit à 35 centimètres.